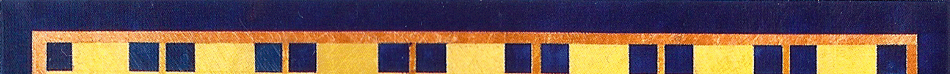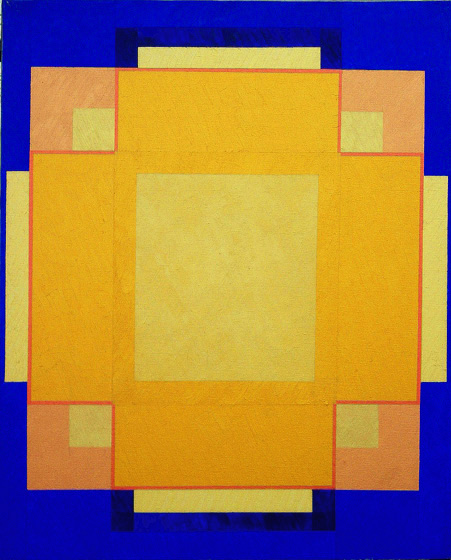Pierre FRESNAULT-DERUELLE, Jovan R. Zec ou L'orient de la peinture.
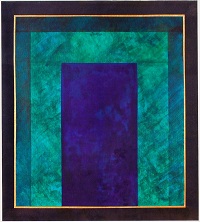
Il s’agit de l’emboÎtement de deux monochromes que double un cadre interne gris-
vert. Celui-ci est à son tour bordé par une
étroite bande dorée, elle-même entourée
par un second cadre, noir celui-là. Ce tableau
est un " temple " que le rectangle sombre,
en son centre, nous fait assimiler à quelque
mastaba (le titre de l'œuvre, évidemment,
n’est pas pour rien dans cette " lecture ").
Mais c’est là se saisir d’un prétexte littéraire
discutable, même s'il est littéralement question d'une " entrée en matière". D'une façon
générale, l'artiste voudra toujours que l’hiératisme de ses compositions (en l’occurrence,
leur sacralité) soit tributaire de figures vraiment instaurées. Rigueur et lyrisme.
L’art abstrait, notamment géométrique, a ceci
de particulier qu’il outrepasse les repères de
la peinture en regard desquels le spectateur
a eu longtemps coutume de trouver ses marques. Malevitch dit, à ce sujet, que la
tâche de l'artiste n'est plus de rendre les
choses, mais de débarrasser les tableaux de
celles-ci! Impossible, de fait, de se situer, classiquement parlant, devant une toile d’Ivan
Klioune, de Ben Nicholson ou d’Aurélie
Nemours chez qui opère l'unique jeu tensif
des formes-couleurs. S’il fallait trouver une
sensibilité artistique à laquelle rattacher l'œuvre de Jovan R. Zec, on mentionnerait volontiers les courants suprématiste et néo
plasticiste. Ces deux courants idéalistes développent, comme on sait, une mystique de
la géométrie proche des recherches rythmiques
de l’artiste qu'on désire aujourd'hui célébrer.
Même si les apparences sont trompeuses,
nous sommes aux antipodes de la lignée
constructiviste (souvent matérialiste) qui,
avec Rodchenko et (parfois) El Lissitzky, veut
que le tableau, considéré comme travail d'ingénierie, soit peint à plat. Refusant cette posture, Zec, qui s'en tient au chevalet, considère
ses tableaux non pas comme des œuvres
faites pour être redressées une fois achevées,
mais des fenêtres d'opportunité que la station debout, seule, permet d'interroger ou
d'activer. Précisons que par " fenêtres d'opportunité ", on entend, non pas, ces lieux
"décalés", saisis par raccroc, tels qu’en peinture figurative, ils apparaissent chez Edgar
Degas ou chez l'américain Edward Hopper,
mais des espaces de facilitation où le subjectile permet à l'artiste de se faire " prospectiviste "(1). On songe aux utopies abstraites
de Lioubov Popova, de Félix del Mare ou de
Jean Gorin qui ne " tiennent" que grâce à
la rigoureuse économie de leurs compositions. Comme nombre de ses frères et sœurs
en modernité, Zec désire que ses propositions visuelles ne " trouent " pas le mur où
elles sont accrochées, mais que, s'enlevant
de ce dernier sans le nier, elles soient également capables de trouver leur place dans la
géographie mentale du spectateur.
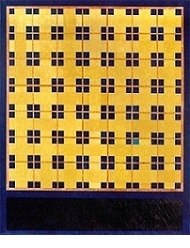
Ce quadrilatère peuplé de fenêtres nous vient
de Byzance du temps de sa splendeur, lorsque
l'Empereur, se souvenant de Rome, répandait
sur la terre les signes de sa puissance. Face
à ce grand carré précieux, dont on pourrait
dire qu’il évoque aussi bien le plan d'un camp
de légionnaires que le motif d’ornementation
de quelque habit sacerdotal, le regardeur se fait contemplateur. Le strict compartimentage de cette acrylique, qui érige la répétition
au rang du principe de constance (à l'exception, on le verra, d'un détail), induit éga-lement l'idée que la variation a été bannie au
profit de cet ordre dont Le Corbusier disait
que sa perception confinait à la plus haute
délectation de l'esprit humain. Linéairement,
ces minces croix rouges, qui se détachent sur
ces cadrans noirs uniformément sertis d'or,
ont quelque chose de la monotonie des
litanies, égrenées encore et encore. Tabulairement, l'ensemble forme bloc, comme forment bloc les temples chargés, en nous
édifiant, de manifester la densité des dogmes
(voyez les cathédrales ou les pyramides).
Nous signalions plus haut la discrète présence d'un élément insolite dans cette
composition : le petit carré bleu, en bas à
droite, de la toile. Pareille à l'unique pièce
allumée d'un immeuble où l'obscurité se serait
étendue, le petit carré bleu introduit une
contre-pointe d'humour dans cet ensemble
grave. Comme s'il s'était agi, malicieusement,
de faire sa part à l'exception: en l'occurrence,
de lever l'hypothèque de l'esprit de système.
Cette dernière remarque s'applique, en vérité,
à toute l'œuvre de notre artiste chez qui la
densité des plages régulées dit à la fois le
besoin de se différencier de la stylistique chrétienne orientale et le désir d'en célébrer, malgré tout, la vertu. ll ressort qu'héritier de l'art
de l’Eglise byzantine, Zec peint d'abord pour
traduire dans son idiome propre certains des
principes esthétiques du langage millénaire
qu'il admire. Sans doute est-ce la raison pour
laquelle le motif premier de la croix se
manifeste aussi sous des formes dérivées: la
croisée, le croisement, les superpositions et
les adjonctions orthogonales. De tout cela,
Zec tire patiemment la structure tramée de
ses contre-mondes. Non sans paradoxe, notre
iconodule se sera fait peintre abstrait pour
transmettre, au-delà du message religieux
stricto sensu, l'irréductible apport plasticien
qui s’y trouve. Faut-il rappeler par parenthèse
qu’avant d’être chrétienne, la croix a pour vocation de dire l’ensemble des figures " agonistes " et antagonistes (haut/bas, masculin/féminin,
fixité/mouvement -dextrogyre ou
sinistrogyre) qui orientent et structurent l’existence? Le mot " abstraction ", concernant
Jovan R. Zec, n’est donc pas qu’une qualification artistique de sa pratique, mais aussi
un terme symbolique qui désigne cette
opération de l’esprit consistant, chez lui, à
isoler un item ou une notion particulière pour
l’élever à la valeur d'une idée globale. Pour
faire bonne mesure, ajoutons que les tableaux
de notre artiste ont parfois l’allure d'habitacles (cf. infra), ce qui entraÎne la question
suivante: quelle articulation établir entre telle
ou telle toile et la salle où l'œuvre doit pouvoir être accrochée ? La géométrie des tableaux
de Zec ne commande-t-elle pas qu'à l’instar
de celle de nombreux créateurs modernes
et contemporains, il soit tenu compte de la
topographie du lieu d'exposition ?
Outre labstraction, la couleur et ses valeurs (que nous traiterons plus loin), la symétrie est au cœur de la démarche de notre artiste que cette dernière soit exaltée ou bien, momentanément, mise en cause.
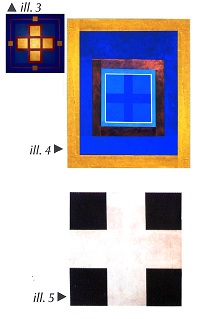
Le motif de la croix, qui se présente régulièrement chez Zec (ill. 3 et 4), doit beaucoup
à Malévitch et ses élèves(3) qui, au début du
XXe s., refondent autant la vertu plasticienne
fondamentale de ladite croix que sa valeur
sémiotique (ill. 5).
Bien des drapeaux ne s'y sont pas trompés,
qui ont allégorisé la croix (grecque ou
romaine) dont on reconnaÎtra aisément qu’elle
est la substructure de tout quadratum :
voyez les couleurs de la Suisse, de la
Grande-Bretagne, de la Grèce, pour ne rien
dire des Pays Scandinaves(4). D’évidence, ce
motif symétrique a quelque chose à voir avec
la problématique de l’équilibre du monde qui
" informe " partout l’œuvre de l’artiste. Néo-platonisme ? Sans doute. Quoi qu’il en soit,
la croix -cette boussole métaphysique- fait le
lien entre la terre et les cieux; avec sa barre
horizontale, elle embrasse la totalité de l’his-
toire des hommes, dont elle est lalpha et
l’Oméga. Ortho-doxie, ortho-graphie.
La symétrie en regard de laquelle la pensée
classique s’éprouve comme complétude peut,
cependant, engendrer l'ennui. Voué à la
reprise, l'artiste doit conjurer les dangers de
la redite. Aussi, parce que la production
sérielle, chez lui, est une nécessité, Zec
cherche-t-il à traiter ses déclinaisons de
manière à ce que celles-ci ne soient que l'affirmation plurielle de l'Un.
Pour ce faire, notre
peintre a recours à l'obliquité. dont on comprendra qu'elle est justement dérogation à la
règle.
Soit cette toile intitulée Illusion visuelle:
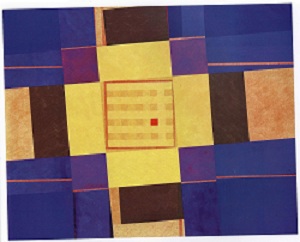
Installé au centre de l'œuvre, mais placé de côté dans le quadrangle régulier constituant son enceinte de protection, le petit carré rouge est le repère à partir duquel le peintre s'est permis un certain gauchissement dans sa composition sans que cette dernière, toutefois, ait à en pâtir. C'est même tout le contraire qui se produit. Si modeste soit-il, ce petit carré rouge compense avec bonheur l’équilibre chancelant du tableau. Si donc l'artiste a introduit du " bruit " dans le code régissant le traditionnel couplage support/surface, il a, tout bien pesé, récupéré rythmiquement ce qu'il aurait pu perdre " ordinalement ". Au statisme des verticales. qui sont en principe dédiées au renforcement des effets d’enca- drement, sont opposées les obliques auxquelles sont conférés les effets dynamiques du cadrage. Mais pas trop. De sorte qu'avec ce système fait de déplacements, de rectifications puis de condensations, Zec a réussi à installer ce punctum qui fait mouche. J'ai beau tenir à distance la croix où il s'inscrit. c’est elle qui me " comprend". Retournement des points de vue : je suis la cible du tableau !
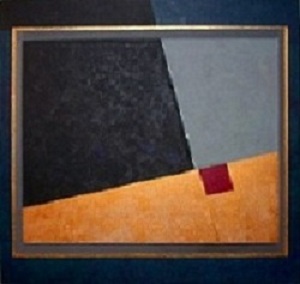
Tel est encore le cas de cette acrylique Tendance d'un carré rouge où le motif du carré
rouge prend sa place dans un dispositif qu'on
pourrait dire être celui du " contrôle mathématisé " (ill. 7). On veut dire qu’ayant désolidarisé l'abscisse et l'ordonnée de ses lignes
(obliques, mais orthonormées) de l'abscisse et de l'ordonnée du support, Zec a créé
une situation aussi prégnante que minimaliste où le petit carré rouge vient bloquer la
montée, le long de la pente jaune, de la puissante plage noire arrivée depuis l'extérieur du
cadre inséré ici. Surprise : la composition,
centrifuge, devient centripète ! Conséquemment, la dite plage noire a beau peser
de tout son poids, rien n'y fait : ce hic écarlate fait de la résistance ! Bien qu'inclinée
de quelques degrés, la croix n'a rien perdu de
sa puissance rectifiante. C'est elle qui a le
dernier mot.
La peinture - vieille antienne - est l'art de penser, de s'exprimer et de s’émouvoir à l'aide de formes, de lignes et de couleurs, Lorsqu'il est figuratif. le propos résulte d'un " arrangement " où l'iconographie, en principe, doit faire la balance avec le traitement des constituants plastiques sollicités ; dans le cas contraire - les compositions abstraites- le peintre ne peut compter que sur la cohérence visuelle de sa composition. Redoutable défi pour l'artiste qui doit ne pas confondre cohérence et cohésion, dont on sait qu'elle (la cohésion) est parfois la marque du formalisme ou de la décoration. Cherchantà définir la poésie, Paul Valéry disait qu'elle est " la continuation d'une hésitation entre le son et le sens ". Toutes choses égales (les motifs prenant la place du son), nous ne saurions mieux dire de l'abstraction géométrique dont le sémantisme (toujours problématique) dépend exclusivement de contraintes formelles longuement travaillées. Car il va de soi - on vient d'en avoir la preuve - que la cohérence des propositions peintes, si celles- ci récusent les significations (c'est le propre de la figuration), n'ont pas vocation à échapper au sens (et aux connotations). Prenant la suite d'un Serguei Senkine, d'un Vladislas Strzeminski ou d'un César Domela. Jovan R. Zec nous conforte dans l'idée que l'esthétique géométrique est, décidément, une des plus belles vues de l'esprit.
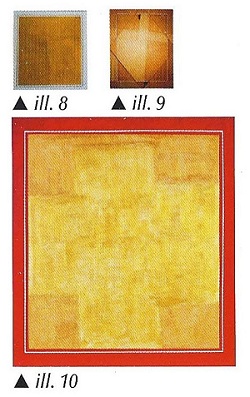
On l'a dit (mais il est temps d’y revenir), l'or
est partout chez le peintre au plus profond
de qui les saintes icônes ont laissé d'ineffaçables traces. On entend par là que, bien que
tributaire des grandes aventures que furent
le Suprématisme et le Plasticisme, Zec n'a pas
fait table rase du passé. Loin des futurismes
tapageurs et de leurs avatars. Zec a ceci de
particulier qu'il réussit la synthèse du géométrisme (réputé froid et tranchant) et du
lyrisme (chaud) : ll est, en vérité, le tenant
d'un nouvel Orphisme qui ne dit pas son
nom(5) chez qui " les voix de la lumière" sont
la grande affaire. Ses tableaux n'évoquent-ils
pas, bien souvent, la translucidité des vitraux
a travers lesquels sourd (ou perce, c’est selon)
l'éclairage d'un jour prodigieusement enrichi ? La technique du peintre est d'une efficacité inattendue, puisque procédant par
recouvrements successifs, Zec semble libérer d’autant la luisance de quelque trésor. A
plusieurs reprises, jovan aura même recours
au monochrome dont l’opacité, proche des
Ultimate Paintings d'Ad Reinhardt, nous
rend " perspicaces "(6). Aussi, l'artiste use-t-
il de sa pratique pour atteindre aux formes
prototypales : proche de la radicalité du Carré
blanc sur fond blanc de Malévitch, le pein-
tre laisse " remonter" certaines de ses croix.
(ill.s 8, 9, 10)
Mais, changeons de focale. lcone, en particulier, évoque le plan (vu d'avion) d’un champ
balisé de fouilles où le zoning du terrain dévoilerait quelque saint des saints. A nouveau,
se manifeste lidée du désenfouissement qui,
s’il fallait encore en apporter la preuve, montre que le traitement des aplats peut atteindre à l'intimité du monde. N’a-t-on pas
souvent comparé la toile du subjectile à un
épiderme(7) ? En somme, l'archaique affleure
chez Zec. Nouvel étonnement de notre part : c’est par ce truchement que Jovan est notre
contemporain.
En quoi ce " moderne passéiste " est-il
notre contemporain ? La réponse nous est
fournie par le philosophe Giorgio Agambem(8)
qui déclarait récemment; " Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai
contemporain, est celui qui ne coÏncide pas parfaitement avec lui ni n'adhère à ses pré-
tentions, et se définit, en ce sens comme
inactuel, mais précisément pour cette raison,
précisément par cet écart et cet anachronisme,
il est plus apte que les autres à percevoir et
à saisir son temps ". Parce qu'il est un artiste
et, qui plus est, un artiste expatrié, Jovan R. Zec fait remonter de derrière le clinquant et
le racoleur qui partout s'étalent cette discrète
mais fondamentale lumière largement invue.
Dans Eloge de l'ombre, Juchiniro Tanizaki
évoque les abus de ce que les Occidentaux
appelèrent " la fée électricité ". Zec, " peintre classique" laisse entendre, lui aussi, qu'il
y a lumière et lumière, lux et lustrum : d'un
côté, la phosphorescence, nécessairement
fragile, des choses importantes ; de l'autre,
la brillance factice des feux de la rampe qui
ont tôt fait de nous aveugler. Sombre constat : la puissance daveuglement n'a jamais été
aussi forte. Et Giorgio Agambem d'ajouter :
" le contemporain est celui qui fixe son regard
sur son temps pour en percevoir non les
lumières, mais l'obscurité. Tous les temps
sont obscurs pour ceux qui en éprouvent la contemporanéité " (9). Reste que Zec ne peint
pas l'obscurité et ses puissances dissolvantes
mais ce qui, contre ces dernières, fait de ses
toiles les étapes d’un cheminement spirituel (10). Michel Seuphor disait que, chez Mondrian, les rythme horizontal et vertical des
tableaux fondent dans linstant présent la
projection finaliste du rêve d'avenir et la fixité
abrupte de la saisie totale (11). Le propos de
Zec est moins radical ; en revanche, il fait de
nous des regardeurs tout autant alertés qu’édifiés.
(1) Le mot " prospectiviste " n’existe pas en français moderne. Il est forgé sur le mot " prospect " qui désigne, chez certains théoriciens de la peinture à l'âge classique, la manière de dépasser le seul " l'aspect " des choses. Le " prospect" est une façon d’activer la manière de voir.
(2) Le passage consacré a cette toile est largement emprunté au texte que nous avons publié sur le site du Musée Critique de la Sorbonne (http : //mucri.univ-paris1.fr).
(3) On songe ici à la croix suprêmatiste d’IIia Tchachnik, ici représentée;
(4) Se réglant sur le fait qu'un drapeau est en revanche volontiers plus large que haut, les emblèmes nationaux tels ceux du Royaume Uni ou des pays scandinaves " couchent " la croix sans amoindrir pourtant l’image chrétienne classique dont ils portent les couleurs. Le drapeau suisse représente, comme on sait, une croix grecque sur un fond rectangulaire.
(5) Avec le mot " Orphisme ", nous nous référons, certes, à ce courant proche des amis peintres d'Apollinaire, mais surtout à l'idée que l’ Orphisme cherchait passionnément la correspondance des harmonies chrom.atiques avec les hargnonies sonores : les " voix de la lumière "(Kupka, Delaunay, etc)'
(6) Le mot " perspicace " vient du verbe perspicere : voir à travers.
(7) Valéry (toujours lui) disait qu'il n'y avait rien de plus profond que la peau.
(8) Ciorgio Agambem, Qu'est-ce que le contemporain ?, Rivages Poche, 2008.
(9) lbid.
(10) Nous prenons le mot spirituel au sens large. On tient qu'avec les tableaux de Zec, croyants et non-croyants peuvent se retrouver : le silence des monastères accueille des athées notoires.
(11) Michel Seuphor, Mondrian, catalogue de l'exposition de l’Orangerie des Tuileries, 1969.